« Comme les cristaux étincelants des grottes »
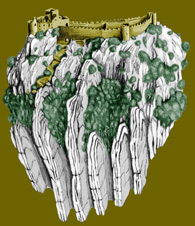
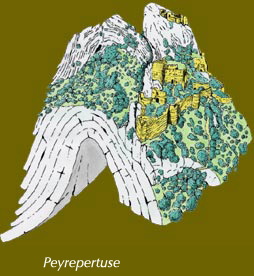
Les
châteaux sont tributaires de leur environnement. Leurs
murs sont faits de roches massives, leurs toits de pierres
plates ou de schistes. Les argiles ont servi à la
confection des briques. Leur situation, sur des reliefs
qui dominent la frontière ou la région, dépend
aussi de l’érosion qui a façonné
leurs promontoires. Ils font corps avec leur décor
naturel. Les cryptes, les sous terrains et les grottes qui
ont marqué l’histoire des châtelains
sont également tributaires de l’architecture
naturelle des massifs. Les bâtisseurs du Moyen Age
ont édifié entre le Vème et le XVIème
siècle, plus de 1000 citadelles qui se découpent
aujourd’hui de loin en loin dans les paysages du sud
de la France. Comme autant d’Arches de Noé
échouées sur autant de Monts Ararat lors de
la dernière transgression marine, ils sont les témoins
d’un passé cataclismique et révolu.

Comme les cristaux étincelants des grottes, ils semblent
être une émanation naturelle de la roche. L’architecture
massive de ces bastions épouse parfaitement la forme
des reliefs. Ils se présentent comme une nouvelle
couche géologique qui n’occuperait que les
sommets des reliefs. Ils sont parfaitement intégrés
au décor, dernière touche à cet impressionnant
tableau réalisé par la nature.
On a l’impression que ces bâtisseurs se refusaient
à voir détruite par l’érosion
cette succession de collines rocheuses qui pointent à
travers une maigre végétation. Ils se sont
acharnés à remonter pierre par pierre les
rochers arrachés à cette masse par les intempéries.
Ils ont patiemment retaillé cette matière
qu’ils ont redisposée, horizontalement, couche
sur couche. C’est un véritable conglomérat
récent qui réutilise les roches des formations
plus anciennes. La mer antique en élaborant les strates
en son sein aurait pu le faire pareillement.
 Cette imitation fortuite de l’œuvre du temps
se retrouve dans les moindres détails. Les voûtes
égueulées du château de Peyrepertuse
ne sont-elles pas dans le même axe que l’immense
voûte naturelle sur laquelle repose le château
? Le vaste berceau de pierre de Montségur n’est-il
pas une copie parfaite des innombrables plis des monts pyrénéens
?
Cette imitation fortuite de l’œuvre du temps
se retrouve dans les moindres détails. Les voûtes
égueulées du château de Peyrepertuse
ne sont-elles pas dans le même axe que l’immense
voûte naturelle sur laquelle repose le château
? Le vaste berceau de pierre de Montségur n’est-il
pas une copie parfaite des innombrables plis des monts pyrénéens
?
On a l’impression que l’homme a rajouté
ici, pierre sur pierre, un élément de sa confection,
parfaitement semblable à ceux élaborés
par la nature, comme pour se fondre en elle sans la choquer.
Il a rebâti à sa manière les montagnes
pour arrêter le temps de quelques siècles.
L’effet de l’érosion a déjà
repris, moins de mille ans plus tard, sa lente besogne destructrice,
pour que l’on se souvienne encore un peu…



 touristique et culturelle intense. La croisade des albigeois a eu pour cadre plus de soixante châteaux forts qui sont pour la plupart situés dans des sites naturels exceptionnels.
touristique et culturelle intense. La croisade des albigeois a eu pour cadre plus de soixante châteaux forts qui sont pour la plupart situés dans des sites naturels exceptionnels. 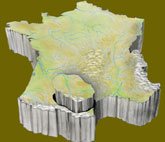
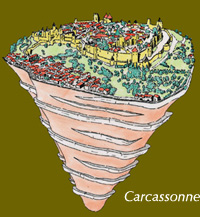
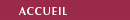
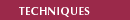
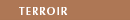
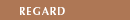

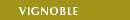
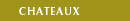
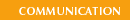

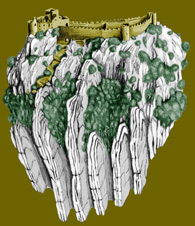
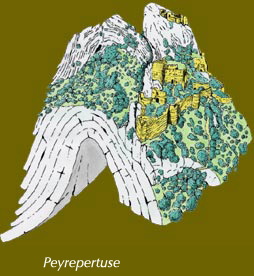 Les
châteaux sont tributaires de leur environnement. Leurs
murs sont faits de roches massives, leurs toits de pierres
plates ou de schistes. Les argiles ont servi à la
confection des briques. Leur situation, sur des reliefs
qui dominent la frontière ou la région, dépend
aussi de l’érosion qui a façonné
leurs promontoires. Ils font corps avec leur décor
naturel. Les cryptes, les sous terrains et les grottes qui
ont marqué l’histoire des châtelains
sont également tributaires de l’architecture
naturelle des massifs. Les bâtisseurs du Moyen Age
ont édifié entre le Vème et le XVIème
siècle, plus de 1000 citadelles qui se découpent
aujourd’hui de loin en loin dans les paysages du sud
de la France. Comme autant d’Arches de Noé
échouées sur autant de Monts Ararat lors de
la dernière transgression marine, ils sont les témoins
d’un passé cataclismique et révolu.
Les
châteaux sont tributaires de leur environnement. Leurs
murs sont faits de roches massives, leurs toits de pierres
plates ou de schistes. Les argiles ont servi à la
confection des briques. Leur situation, sur des reliefs
qui dominent la frontière ou la région, dépend
aussi de l’érosion qui a façonné
leurs promontoires. Ils font corps avec leur décor
naturel. Les cryptes, les sous terrains et les grottes qui
ont marqué l’histoire des châtelains
sont également tributaires de l’architecture
naturelle des massifs. Les bâtisseurs du Moyen Age
ont édifié entre le Vème et le XVIème
siècle, plus de 1000 citadelles qui se découpent
aujourd’hui de loin en loin dans les paysages du sud
de la France. Comme autant d’Arches de Noé
échouées sur autant de Monts Ararat lors de
la dernière transgression marine, ils sont les témoins
d’un passé cataclismique et révolu.
 Cette imitation fortuite de l’œuvre du temps
se retrouve dans les moindres détails. Les voûtes
égueulées du château de Peyrepertuse
ne sont-elles pas dans le même axe que l’immense
voûte naturelle sur laquelle repose le château
? Le vaste berceau de pierre de Montségur n’est-il
pas une copie parfaite des innombrables plis des monts pyrénéens
?
Cette imitation fortuite de l’œuvre du temps
se retrouve dans les moindres détails. Les voûtes
égueulées du château de Peyrepertuse
ne sont-elles pas dans le même axe que l’immense
voûte naturelle sur laquelle repose le château
? Le vaste berceau de pierre de Montségur n’est-il
pas une copie parfaite des innombrables plis des monts pyrénéens
?